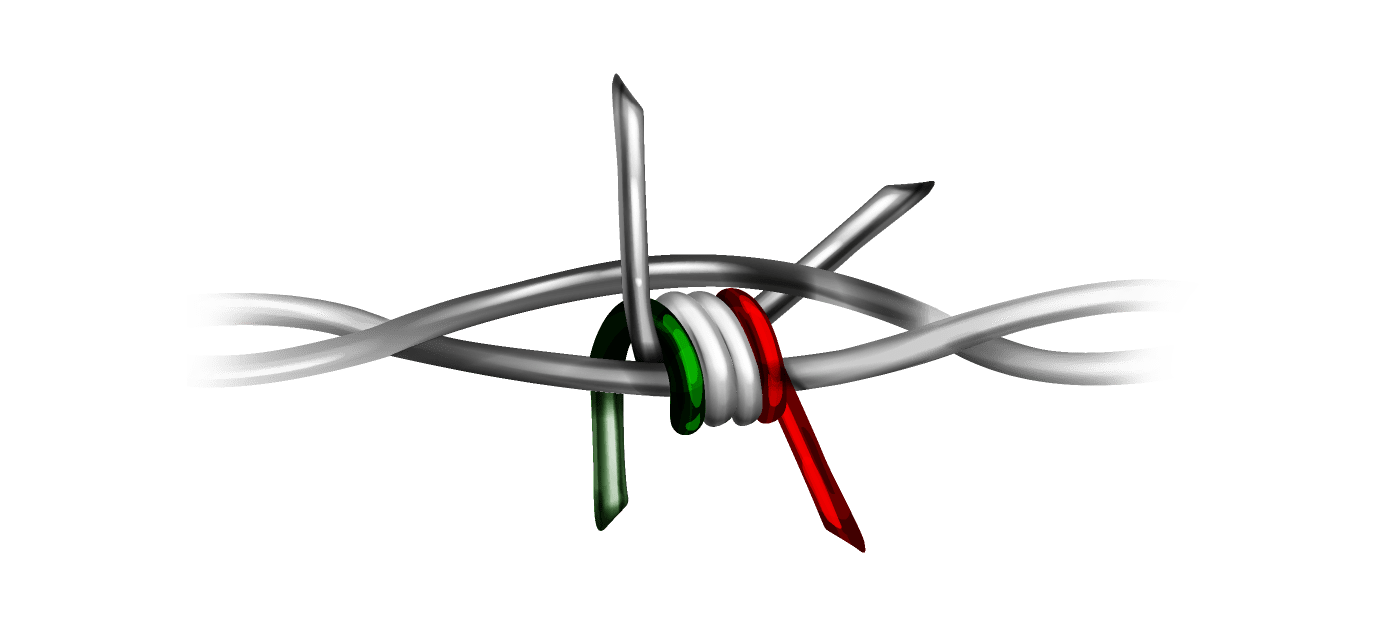L’épreuve de la captivité
À partir du jour où nous avons eu le malheur de tomber entre les mains de l’ennemi comme prisonniers de guerre (octobre 1917), c’était comme si nous étions tombés au fond d’un abîme. »
« Les Italiens de Moschamps » à Isabella Errera, 9 septembre 1918
Pourquoi des prisonniers de guerre italiens en Belgique et en France occupées ?
La présence en Belgique et en France occupées de prisonniers issus de l’armée italienne, engagée sur le front alpin, peut paraître surprenante. Mais elle s’explique aisément. Elle est directement liée à la bataille dite de Caporetto, qui se déroula du 24 octobre au 9 novembre 1917, et fit reculer la ligne de front de 150 kilomètres, jusqu’au fleuve Piave. Au 31 décembre 1917, l’armée italienne aura perdu 335 000 soldats faits prisonniers, sur le sol de leur patrie, par les troupes allemandes et austro-hongroises. Cet immense butin humain, absolument inattendu, est d’emblée perçu comme une opportunité par l’état-major allemand – contrairement à son homologue austro-hongrois, qui y verra une charge difficile à gérer. Berlin exige que la moitié de ces prisonniers soient emportés en Allemagne. L’objectif est de mettre ces hommes au travail – de les transformer en main-d’œuvre utile. L’économie allemande souffre en effet, en cette fin d’année 1917, d’une pénurie de bras. De plus en plus d’Allemands sont appelés au front, abandonnant leurs postes de travail. La réquisition et la déportation de contingents de civils depuis les territoires belges et français occupés ne suffit pas à combler les besoins – et a, en outre, soulevé une vague d’indignation dans les pays ennemis qui ne fut pas sans conséquences diplomatiques. L’état-major allemand imagine alors élargir le service civil obligatoire à de nouvelles catégories de nationaux, ce qui ne va pas sans opposition politique interne. Bref : 150 000 hommes tombés du ciel, taillables et corvéables à merci, cela représente une vraie aubaine pour Berlin.
La plus grande partie de ce contingent de prisonniers italiens est affectée en différents lieux d’Allemagne (usines, chemins de fer, agriculture, etc.). Mais 11 000 d’entre eux (soit 22 compagnies de prisonniers sous autorité allemande) sont envoyés dès décembre 1917 en Belgique et en France occupées, toujours dans le but d’être mis au travail.
Par suite de la paix séparée conclue avec la Russie durant le même mois de décembre, prévoyant le rapatriement des prisonniers russes détenus par les Allemands, Berlin réclame à son allié de Vienne un nouveau contingent de prisonniers italiens, en vue de remplacer leurs homologues russes. Une seconde vague de transfert vers la Belgique et la France est alors organisée en mars 1918, comprenant 72 compagnies de prisonniers, soit 14 000 hommes, placées sous autorité austro-hongroise, mais mises au service des besoins allemands.
Au total, ce seraient donc 25 000 prisonniers italiens qui auraient été envoyés entre décembre 1917 et mars 1918 à l’arrière du front ouest, dont la plus grande partie sur le sol français. Cependant, un rapport confidentiel allemand daté du 23 novembre 1918 évalue à 38 000 le nombre de soldats italiens détenus dans les territoires belges et français occupés le jour de l’armistice.
La présence de prisonniers de guerre italiens sur les sols belge et français est donc à la fois tardive (elle débute à la fin du mois de décembre 1917), réduite (la majorité des prisonniers italiens de Caporetto étant localisés en Allemagne et en Autriche-Hongrie) et purement logistique (elle ne relève ni d’une logique de représailles militaires, ni d’un besoin de trouver de nouveaux lieux de détention parce qu’il en aurait manqué en Allemagne). Les transferts de ces prisonniers doivent être compris comme des déplacements de main-d’œuvre, organisés de manière unilatérale par un État en guerre.
Quels furent les travaux auxquels furent astreints les prisonniers italiens ?
S’il est incontestable que toutes les compagnies de travail de prisonniers italiens furent mises au service de l’effort de guerre allemand, il est tout aussi évident que les tâches effectuées et les conditions dans lesquelles elles étaient exécutées furent variées. On peut distinguer six catégories de situations, dont certaines recouvrent plusieurs types de travaux (dont les symboles repris entre parenthèses se retrouvent sur la carte des camps) :
1) En zones d’opérations 
Des prisonniers italiens se retrouvent à proximité directe du front, notamment dans les coulisses des théâtres d’affrontements majeurs des années 1917 et 1918 : à Courtrai devant Ypres, à Lille-Roubaix-Tourcoing devant Armentières, à Douai et Cambrai devant Bapaume, à Laon devant le Chemin des Dames, à Rethel devant Reims ou à Mulhouse sur le front des Vosges. Ils y débarquent en grand nombre, puis sont répartis par sections en différents lieux pour effectuer des travaux de soutien. Par exemple, dans les Flandres, des prisonniers italiens sont internés à Staden et Moorslede, deux villages situés chacun à moins de dix kilomètres de Poelkapelle, où passe la ligne de front du saillant d’Ypres ; ils y effectuent des travaux de manutention dans des dépôts de munitions. Dans les environs d’Halluin ou de Cambrai (en France), d’autres sont affectés au renforcement de tranchées, en compagnie de civils belges contraints au travail obligatoire. On retrouve la même situation à Noyelles-sur-Escaut, à quelques kilomètres de Cambrai, où des prisonniers italiens sont employés pour l’approvisionnement du front en munitions ; ou encore dans le saillant de Saint-Mihiel, en Meurthe-et-Moselle, où ils réparent les routes entre Thiaucourt et la ligne de front, située cinq kilomètres plus loin.
2) Les nœuds logistiques 


Intimement liés aux zones précédentes, mais plus distants du front, ces lieux ont une importance stratégique majeure, puisqu’ils permettent l’approvisionnement du front en hommes et en matériel. Ils sont l’objet d’investissements importants de la part des Allemands, mais aussi les cibles de l’aviation alliée. Les travaux sont donc nombreux, allant de la manutention de matériel dans les Pionierparken à la construction, l’entretien et la réparation des voies de communication, routes, canaux, voies ferrées ou terrains d’aviation (Bruges, Izegem, Jabbeke, Landen, Marke, Muizen, Oostkamp, Petegem, Roulers, Tielt, Bruxelles, Libramont, Virton, Hirson, Steinbrunn-le-Haut, ou encore Berchem au Luxembourg), en passant par des tâches de main-d’œuvre dans les cantonnements et hôpitaux (Etreux, Metz, Sedan ou Trélon).
3) Les bassins industriels 
Indispensables à la machine de guerre allemande, les bassins houillers et pétrolifères de Lorraine exigent de la main-d’œuvre nombreuse. Au début de l’année 1918, des prisonniers italiens arrivent dans les vallées de la Fensch et de l’Orne, entre Briey et Thionville (Moyeuvre-Grande, Basse-Yutz), ainsi qu’à Deutsch-Oth (Audun-le-Tiche) dans le bassin de Longwy. Il est à noter que dans ces régions les prisonniers italiens furent utilisés à la fois à l’exploitation des installations et à leur destruction. Alors qu’à Pechelbronn les prisonniers italiens sont chargés de creuser un nouveau puit de forage, à Halanzy, Musson, Sclaigneaux, Acoz, Joeuf ou Micheville leur travail consiste à démanteler les machines et les hauts-fourneaux. En effet, les Allemands avaient entrepris depuis 1917 le démontage et la démolition d’un certain nombre de sites industriels en France et en Belgique. Pour accomplir cette tâche, ils mobiliseront de nombreux prisonniers civils et militaires, dont des Italiens.
4) Carrières et forêts 

Des prisonniers italiens sont également affectés à l’activité d’extraction d’autres ressources naturelles, principalement la pierre et le bois. Ces lieux, plus clairsemés, sont généralement situés au-delà des zones des étapes, à l’écart de centres stratégiques, mais sont indispensables pour fournir les matières premières dont ils ont besoin. Les exploitations forestières où furent affectés des prisonniers italiens sont celles de Moussey dans les Vosges (à une distance de quelques kilomètres de la ligne de front) et des Ardennes belges (Mochamps, Membach) et françaises (La Besace, Saint-Fergeux et « Le Chesne où des prisonniers italiens mourront de faim ») ; les hommes y abattent et y transforment les grumes fournissant le bois nécessaire à la construction des tranchées et des baraques. Cette catégorie recouvre également les carrières de pierres de Quenast, d’Olloy-sur-Viroin et d’Acoz et diverses exploitations du pays d’Andenne en bord de Meuse, ainsi qu’en France les carrières de gypse de Montigny-les-Metz. Les prisonniers italiens n’y sont pas affectés par hasard : tous ces établissements, dont les produits sont essentiels à l’effort de guerre allemand, sont en manque de main-d’œuvre soit à la suite de leur mise sous séquestre dans les années précédentes, soit du fait qu’ils n’existaient tout simplement pas avant la guerre (comme dans les cas de l’exploitation des forêts domaniales de l’Hertogenwald septentrional et de Freyr à Mochamps).
5) Travaux agricoles 
On notera également quelques cas de compagnies de prisonniers affectées à des travaux agricoles (Attigny, Fraillicourt, Muespach ou Obernai). Leur nombre en France semble proportionnellement beaucoup plus réduit qu’en Allemagne ou en Autriche-Hongrie, où l’affectation de prisonniers italiens dans l’agriculture était fréquente. En revanche, nous n’avons recensé aucun cas sur le territoire belge.
6) Cas isolés
Enfin, on recense quelques situations particulières : à Obernai, en Alsace, des prisonniers italiens sont répartis chez des particuliers pour y travailler comme domestiques, par exemple dans une distillerie ; à Huy, en Belgique, un groupe de douze prisonniers est interné dans un garage pour gérer les livraisons arrivant par chemin de fer, tandis qu’un autre prisonnier, isolé, travaille pour un soldat autrichien établi en ville. À Oostkamp, trois prisonniers italiens, dont les sentinelles avaient remarqué les dons artistiques, furent envoyés dans l’atelier du peintre Jules Roets, un artisan de la localité, où ils réalisèrent des sculptures et fabriquèrent des moules pour des décorations en plâtre. Enfin, nous ne connaissons que deux cas où des prisonniers italiens ont travaillé dans l’industrie de production aux côtés d’ouvriers civils : à Graffenstaden près de Strasbourg (usine de matériel ferroviaire) et à Gentbrugge près de Gand (dans l’usine de tréfilage dite Puntfabriek, même si leur présence reste à ce jour insuffisamment documentée).
En définitive, il n’y a jamais eu, en Belgique et en France occupées, de grands camps de concentration pour prisonniers italiens, comme il en fut de très nombreux en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Les camps y étaient toujours de petite taille, contenant une ou deux compagnies au maximum, et souvent des contingents plus réduits. Le seul lieu de grande concentration fut la Citadelle de Liège, où plusieurs centaines de prisonniers italiens furent enfermés dans des conditions inhumaines. Pour les Allemands, elle constitue une véritable plaque tournante dans le dispositif de transfert massif de prisonniers de guerre. C’est là que sont véritablement parqués, de manière plus ou moins temporaire, ceux d’entre eux qui ne peuvent être exploités dans les compagnies de travail actives dans les territoires occupés. Un habitant de Liège témoigne : « J’ai vu des soldats de toutes nationalités qui, devenus impotents dans les camps de travail du front, étaient envoyés en repos à la Citadelle de Liège, d’où ils ne sortaient que pour être renvoyés encore au labeur forcé, dans la ligne de feu, ou réinternés en Allemagne. Nous sommes allés en prendre des centaines au pied de la rue Pierreuse, afin de les munir d’un peu de pain avant leur départ ». Des rescapés italiens diront de leur séjour à la Citadelle : « En l’espace de dix mois, c’est-à-dire la durée de notre séjour, nous avons vu jusqu’à 700 Italiens revenir des privations et des souffrances du front. Liège marque la période infernale de notre vie de captifs ».
Quel fut le traitement réservé aux prisonniers italiens ?
Pour ces hommes condamnés à la servitude invisible des commandos de travail dans les territoires occupés de Belgique et de France, la liste des épreuves qu’ils eurent à endurer est bien longue : la faim, l’épuisement, la maladie, les coups, les exécutions sommaires, le désespoir et, pour certains, les bombardements. Les milliers de tombes de prisonniers italiens en restent aujourd’hui les traces les plus tangibles.
La faim frappa les prisonniers dès les premières heures de leur capture sur le front italien, et les accompagnera jusqu’à la fin de leur captivité. Elle est particulièrement intense dans les jours et semaines qui suivent la débâcle de Caporetto, moins par une volonté délibérée des Austro-Allemands d’affamer leurs prisonniers que par l’absence d’anticipation de leur nombre pléthorique. L’organisation de leur évacuation et de leur intendance est insuffisante au regard des besoins. Certains prisonniers ne résistent pas à cette terrible épreuve, comme ceux qui succombent à Obernai en janvier 1918, entre autres. Durant cette période, les prisonniers en sont réduits à ingurgiter des navets gelés, des pelures de pommes de terre ou même de l’herbe. Ils échangent le moindre objet qu’ils possèdent (décorations d’uniformes, montres, porte-plumes, bout de ferraille sculptés, etc.) contre un peu de nourriture. Une fois répartis et installés dans leurs affectations définitives, la malnutrition va s’atténuer progressivement, mais sans jamais disparaître. En attestent, par exemple, les scènes vécues à Metz et Thiaucourt durant l’été 1918 par le soldat allemand Dominique Richert.
L’épuisement sera le premier corolaire de cet état de famine et des trajets et travaux interminables que vont connaître les prisonniers italiens. Tous les témoignages soulignent leur état famélique : ces hommes sont hâves, pâles, jaunis, misérables. Le jeune Yves Congar, à Sedan, écrit : « ils sont maigres, jaunes, leur figure, fatiguée, jaune, brune même est décharnée, les joues creuses, les lêvres blanches, les yeux noirs et langissants, la peau ridée ». D’autres les décrivent comme des spectres, des squelettes, des « fantogrammes ». Pour ne citer qu’un exemple, le soldat Antonio Gatti, prisonnier cantonné dans la forêt à Mochamps, s’éteint d’épuisement le 30 juillet 1918 à l’âge de 43 ans dans un baraquement du camp, sans recevoir aucune aide de la part de ses gardiens.
La maladie sera l’autre conséquence inévitable de ces transferts épuisants. La dysenterie, la grippe et la tuberculose font des ravages. Les prisonniers les plus fortement touchés sont envoyés vers des hôpitaux militaires allemands (Anvers, Liège, Lille, Maubeuge, Metz, Mons, Namur, Tournai, Trélon, Virton, etc.), où ils sont abandonnés à leur sort bien plus qu’ils ne sont soignés. Nombre d’entre eux n’en reviennent pas. Leurs tombes s’alignent dans les cimetières proches.
Les prisonniers sont également confrontés à l’épreuve des coups. Ils tombent sur le détenu qui brave la règle qui lui est imposée. L’architecte roubaisien Paul Destombes raconte ce qu’il a vu à Croix en février 1918 : « Si l’un des Italiens fait mine de sortir tant soit peu du rang, subitement le bâton le ramène à la façon du bouvier qui dirige son bétail à l’abattoir, quand ce n’est pas la crosse qui agit avec encore plus de rigueur encore. Un de ces malheureux a été aperçu les deux bras accrochés aux épaules de ses camarades, anéanti par la faim et par la fatigue, se traînant plutôt que marchant vers un calvaire ». à Mons, une certaine Mademoiselle Heupgen « voyait passer chaque matin devant chez elle une pitoyable théorie de prisonniers italiens conduits par une chiourme autrichienne qui les fouaillait d’une sorte de knout à longue et terrible lanière. Elle a vu le dos d’un de ces malheureux : ce n’était plus qu’une plaie tuméfiée, sanglante ». Par ailleurs, quelques témoignages de scènes d’humiliation nous sont parvenus : celles infligées par le Major Meyer aux prisonniers de la Citadelle de Liège ou celle que fit subir à Mario Bosisio le sergent-infirmier du camp d’Olloy-sur-Viroin. D’autres ont existé, à n’en pas douter.
Stade ultime de la violence, des exécutions sommaires frappèrent également les prisonniers italiens : elles sont attestées à Aartrijke, à Courtrai, à Libramont, à Marke ou encore à Rienne. À chaque fois, il s’agit de situations dans lesquelles un prisonnier « quitte le rang » de sa propre initiative, non pour s’enfuir mais pour se nourrir ou réparer le toit de son baraquement. Le récit de Julie Cattrysse nous apprend néanmoins que cette violence n’était pas encouragée par l’autorité allemande, bien au contraire : le Feldgendarm qui tua le prisonnier Francesco Mondelli, le 24 avril 1918 à Aartrijke, fut sanctionné par sa hiérarchie et envoyé au front pour son crime. Plusieurs autres témoignages indiquent eux aussi que la violence physique et morale n’était pas une pratique systématique de la part des gardiens, et que certains s’en abstenaient voire entretenaient des relations respectueuses envers leurs prisonniers.
Chez de nombreux prisonniers, ces conditions de vie dégradantes engendrent un désespoir profond. La tentative de suicide de Mario Bosisio en est l’expression la plus tragique. Combien d’autres prisonniers furent poussés aux mêmes extrémités ? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, en revanche, c’est qu’ils furent tous affectés par l’éloignement vis-à-vis de leurs familles et par le manque de communication avec elles. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’absence de courrier à destination des prisonniers ne résultait pas d’une interdiction allemande, mais bien de la volonté des autorités militaires italiennes.
En avril 1918, à Rome, le délégué du gouvernement italien déclare devant le parlement qu’il « a protesté, à réitérées fois, par l’entremise de la Suisse, contre le traitement inhumain appliqué aux prisonniers italiens internés en Allemagne » (La Liberté, 27 avril 1918, p. 3). Mais derrière ces déclarations politiques se cache un refus obstiné des autorités militaires de leur venir en aide. Depuis Caporetto, leurs attitudes envers les soldats tombés aux mains de l’ennemi sont totalement avilissantes. Après que le généralissime Cadorna ait publié le 28 octobre 1917 un bulletin dans lequel il dénonçait les soldats qui « ont vilement battu en retraite, sans combattre et qui se sont ignominieusement rendus à l’ennemi », l’état-major italien interdit strictement tout envoi de colis aux prisonniers détenus en Allemagne. En février 1918, il autorise néanmoins la Croix-Rouge à leur fournir des vivres, prolongeant l’interdiction pour les envois par les familles. En mars et avril, du fait de la grande offensive allemande de printemps, les frontières sont fermées et plus aucun convoi ne les franchit. Il faut attendre l’été pour que des paquets circulent à nouveau, comme en atteste, entre autres, le témoignage de Zappellini (il reçoit ses premiers paquets en août et son premier télégramme en septembre 1918). Contrairement à ses homologues français, britannique et allemand, le pouvoir militaire italien restera intraitable jusqu’à l’armistice : il n’organisera aucune aide pour ses prisonniers. Le moral de ces derniers en pâtira profondément, sans parler du sentiment de honte qui les accablera pendant de très nombreuses années.
Enfin, certains prisonniers connurent l’horreur des bombardements. Ce fut le cas de ceux qui travaillaient au plus près de la ligne de front, à réparer les routes et les dispositifs de défense ou à transporter du matériel et des munitions. Là, les canons anglais ou français frappent de manière aveugle, fauchant leurs ennemis allemands autant que leurs alliés italiens. Le 16 juillet 1918, un bombardement sur Moorslede (près de Ypres) aurait fait comme victimes deux soldats allemands, cinq travailleurs civils belges et quatre prisonniers italiens, selon le témoignage d’un habitant. à Valenciennes, des prisonniers italiens sont blessés et tués par des obus britanniques, en juillet et août 1918 respectivement. On retrouve les mêmes scènes dantesques à Cambrai ou à Moyeuvre-Grande dans le bassin de Briey.
Comment les populations locales réagirent-elles à la présence de prisonniers italiens ?
Si, en 1915, l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés des pays de l’Entente (France, Grande-Bretagne et Russie) avait été saluée avec joie, il règnera en Belgique et en France dans les années suivantes une piètre opinion au sujet de l’armée italienne, jugée incapable d’avancées décisives face à son ennemi austro-hongrois. Plusieurs livres tenteront de donner une image plus positive des alliés transalpins : L’Effort italien, publié en 1916 par Louis Barthou, l’ancien Président du Conseil ; En Italie pendant la guerre, publié la même année par Jules Destrée, député en exil du Parti Ouvrier Belge ; ou encore l’ouvrage du père de Sherlock Holmes, le célèbre écrivain britannique Arthur Conan Doyle, A Visit to Three Fronts: Glimpses of the British, Italian and French Lines, paru lui aussi en 1916. Mais ces écrits ne pouvaient pas être lus par les habitants des territoires envahis. En revanche, la nouvelle de la débâcle italienne à Caporetto sera amplement diffusée par la presse sous contrôle allemand. L’image de l’Italie en sort salie, comme l’expriment les témoignages de nombreux Belges et Français, à la fois fâchés et désespérés par cette retraite qui venait confirmer, à leurs yeux, les faiblesses de cet allié lointain : « les Italiens détalent comme des lapins, se font enfoncer et cerner » ou « Les Italiens, on n’en parle plus, ils sont Kapout. Nous sommes propres !!! », écrit par exemple Henri Camus, un dentiste de Maubeuge, en novembre 1917.
Cependant, l’événement que constitua, dans une localité, l’arrivée d’un nouveau contingent de prisonniers va changer la donne. La présence de prisonniers italiens ne laisse pas les habitants indifférents. Ainsi vont naître entre ces deux groupes plusieurs formes de relations, rendues matériellement possibles par leur proximité prolongée. En effet, les lieux où logent et travaillent ces prisonniers sont pour la plupart situés au cœur ou en bordure immédiate de centres habités, hameaux, villages ou villes. Les soldats italiens ne sont plus, désormais, des figures de cartes postales patriotiques ou ces inconnus d’au-delà des Alpes croqués par les communiqués de guerre : ils vivent, et tentent de survivre, devant les yeux belges et français. On va alors voir apparaître parmi la population les signes d’un élan de proximité patriotique avec ces soldats étrangers qui eux aussi avaient combattu l’Allemagne – laquelle continuait à leur infliger de terribles souffrances ici même, sur leur propre sol. Civils belges ou français et prisonniers italiens partageaient maintenant cette « prison commune » qu’était le territoire occupé par l’Allemand. Les relations de compassion et de solidarité qui se nouèrent progressivement entre eux prirent trois formes principales.
La première relève d’échanges informels et discrets. Plusieurs témoignages évoquent les gestes spontanés d’adultes ou d’enfants donnant de la nourriture aux prisonniers affamés (par exemple à Tielt, Bekegem, Marke, Loppem, Malines, Cambrai, Croix, Neuville-en-Ferrain ou Sedan). Dans cette « société de privation » qu’est la Belgique ou la France occupée, la figure famélique du prisonnier italien ravive un sentiment d’injustice fortement prégnant depuis 1914 ; et comme la population partage largement l’idée que chacun doit faire des sacrifices pour aider les autres, on peut comprendre la multiplication de ces gestes de solidarité, autant que leur importance symbolique. Dans certains cas, ces pratiques revêtent même une certaine régularité, civils et prisonniers inventant des stratagèmes pour déjouer la surveillance des gardiens. À Oostkamp, des femmes et des enfants déposent de la nourriture le long de la rue, afin que les prisonniers puissent la ramasser en passant. À Loppem, un atelier clandestin installé dans la maison de la famille Coppieters « produit avec diligence des pantalons, des chemises et des sabots à partir de toutes les chutes envoyées de Bruges et des environs. Ces choses sont ensuite remises aux prisonniers en secret. Toute la population s’efforce de les aider, malgré la rareté de la nourriture », comme le confie l’avocat Joseph Coppieters dans son journal de guerre. Et à Aartrijke, la jeune Julie Cattrysse, désirant fournir aux pitoyables prisonniers italiens quelques patates supplémentaires par rapport à la ration qu’elle était chargée de leur distribuer au magasin de ravitaillement militaire allemand où elle était affectée en compagnie d’autres femmes du village, eut recours pour ce faire à différentes « astuces » qu’elle avait éprouvées depuis longtemps déjà pour dérober de la nourriture aux Allemands. Ces pratiques clandestines étaient risquées, tant pour les civils que pour les prisonniers : dans plusieurs localités, des interdictions d’approcher les prisonniers furent décrétées et des amendes ou des peines d’emprisonnement infligées pour leur irrespect. Dans certains cas (Quenast, Oostkamp), les communes furent contraintes de faire elles-mêmes respecter cette interdiction.
Un autre canal de relation entre les prisonniers italiens et le milieu environnant fut entretenu par les ecclésiastiques catholiques. Le secours spirituel et matériel des prêtres s’observe en presque tous les lieux où sont présents des prisonniers italiens, sans compter la sollicitude de diverses communautés monacales féminines. On peut y voir la prolongation moralement logique de l’engagement humanitaire intense dont les ecclésiastiques faisaient preuve depuis le début de l’occupation, animés par les valeurs d’endurance et de patriotisme dont le Primat de Belgique, le cardinal Mercier, s’était fait le héraut localement et internationalement reconnu. On peut également y trouver l’expression (explicitement assumée) d’une solidarité proprement confessionnelle, visant à soutenir l’expression de la culture (et du salut) catholiques de ces Italiens encadrés par des gardiens et des aumôniers majoritairement protestants.
En Belgique, les autorités catholiques s’investissent également dans la cause des prisonniers italiens. Les évêques de Liège (Mgr Rutten) et de Namur (Mgr Heylen) furent particulièrement actifs, mobilisant la charité des fidèles, intervenant auprès des pouvoirs allemands, envoyant des émissaires (tels les chanoines Jean Schmitz ou Alfred le Grand) dans les camps de prisonniers inclus dans leur juridiction ecclésiastique (celle de Namur s’étendant en partie sur les Ardennes françaises) ou produisant des rapports à destination du Saint-Siège. Le Vatican lui-même ne fut pas en reste : outre les appels réitérés du nonce apostolique à Munich, Mgr Pacelli, pour venir en aide aux prisonniers italiens en Allemagne, le nonce apostolique en Belgique, Mgr. Locatelli, visita la Citadelle de Liège en mai 1918 et envoya au Vatican un rapport accablant sur la situation dans la prison-hôpital où croupissaient 700 soldats italiens (le cimetière de Robermont verra se multiplier les sépultures de ces maltraités, dont le nombre total s’élèvera à 185). Il suggéra la mise en place d’une aide alimentaire par l’intermédiaire de personnalités belges « dont l’honorabilité serait reconnue », car les Italiens ne bénéficiaient d’aucun secours organisé, contrairement aux prisonniers britanniques et français. Ces différents rapports décideront le Pape Benoît XV à ordonner en juillet 1918 à la nonciature de Bruxelles l’envoi de vivres et d’argent aux prisonniers italiens détenus en Belgique.
Un dernier canal de relations avec les prisonniers italiens prit la forme d’initiatives civiles officielles. La mieux connue – et sans doute la plus importante dans son ampleur – est la création par Isabella Errera-Goldschmidt (1869-1929), en mai 1918, de l’Œuvre d’assistance aux prisonniers Italiens déportés en Belgique. Gérée depuis Bruxelles, elle va assurer jusqu’à la fin de la guerre l’envoi de colis et l’organisation de visites dans plusieurs camps, à savoir ceux d’Acoz, Andenne, Landen, Libramont, Mochamps, Muizen, Namur, Neuville-sous-Huy et Quenast. Le grand album photographique offert à Isabella Errera raconte en images le fonctionnement de son Œuvre – on en retrouve l’intégralité sur notre site. D’autres initiatives ont existé, comme des distributions de nourriture aux prisonniers italiens organisées par certaines municipalités françaises. Le maire délégué de Cambrai, Jonathan Demolon, relate l’une de celles-ci, tenue quelques jours avant Pâques 1918 : « Dernièrement, une corvée de prisonniers italiens venait chercher du pain à la mairie, et le sous-officier italien servant d’interprète trouvait le moyen de me dire cette simple phrase combien émouvante : “Monsieur, vous nous avez sauvé la vie.ˮ ».
Cette « simple phrase » exprime bien plus profondément que tous les mots savants ce qu’a pu représenter, pour tous les prisonniers de guerre italiens, l’épreuve de la captivité.